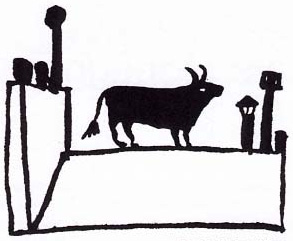|
Evocations des «dîners du samedis», au fil de la lecture de «Raymond Radiguet ou la jeunesse contredite - 1903 - 1923» de Marie-Christine Movilliat, - Editions Bibliophane-Daniel Radford 1918-1919 : Au mois d'octobre, c'est sous l'impulsion du poète qu'ont commencé ces dîners hebdomadaires, et tous ceux qu'il serre autour de lui - ils seront de plus en plus nombreux - en vanteront longtemps les plaisirs, la bonne humeur. Chaque semaine, on se réjouit du prochain samedi. Manquer un samedi est une idée que personne n'envisage. Du moins au début. Parlant de ces dîners qui durèrent deux ans, lors d'une conférence au Collège de France en 1923, Jean Cocteau dit qu'ils furent abandonnés parce qu'ils devenaient une v&ecute;ritable institution, voire une obligation, et que lui-même en venait à être vexé par une défection comme jadis son grand-père quand quelqu'un manquait une réunion de famille. Reste que son prestige rassemble, dès le premier hiver, des personnalités fort différentes qui sans lui ne se seraient sans doute jamais rencontrées. Les premières rencontres ont lieu chez Darius Milhaud, qui habite à Montmartre avec Héloïse, sa vieille bonne venue d'Aix, un petit appartement tout tapissé de vert, au 5 rue Gaillard, dans le haut de la rue Blanche. On prend des cocktails, particulièrement redoutables le soir où Paul Morand les compose à base de désinfectant, quand ce n'est pas Lucien Daudet qui a le shaker mauvais... Ensuite, pique-nique sur place, ou dîner au Petit Bessonneau, un bistrot de Montmartre (alors Max Jacob est de la fête) à la portée de toutes les bourses. Personne, sauf Poulenc, n'étant bien riche, chacun paie son écot. (...) On bavarde en confiance. Les conversations les moins concertées de cette pléiade brillante finissent immanquablement sous la houlette de son astre majeur, Jean Cocteau. Il rode sur les convives comme sur un brouillon ces bulles sonores qui vont devenir livres, articles, répliques d'acteurs, poèmes. Pas le moindre ragot, pas la moindre vulgarité, rien n'est dit qu'il ne pourrait écrire. Après dîner, on va à la foire de Montmartre sur le boulevard Clichy, ou au cirque Médrano : on manque rarement l'entrée des trois Fratellini, clowns, comédiens, acrobates, musiciens, dignes de la commedia dell'arte. La soirée se termine dans l'appartement de l'un ou l'autre par de la poésie, de la musique ou quelque facétie. Mais le besoin de faire, d'agir, de créer, survit à tous les surmenages mondains et le temps des samedistes ne se passe pas tout entier en festivités. Les musiciens composent, Lucien Daudet ombre des portraits à la mine de plomb, et tient son journal, Irène Lagut peint ses écuyères et ses chevaux de cirque, Jean Hugo grave des paysages sur linoléum, Valentine dessine, Jean Cocteau travaille à une pantomime, Paul Morand rédige ses nouvelles, Radiguet écrit un peu, lit, observe beaucoup. Chacun est emballé par chacun. «Nous sommes SAM, proclamera ouvertement le premier numéro du Coq, organe de presse du groupe : Société d'Admiration Mutuelle.»
L'amour du théâtre, le souvenir
de Parade ont donné à Cocteau l'envie de se consacrer de nouveau à la
scène et d'écrire une vraie farce. Quand le compositeur (Darius Milhaud)
comprit ce que voulait faire son ami, il songea à un titre, celui d'une
rengaine entendue au carnaval de Rio, O boi no telhado, «Le Boeuf sur le
Toit». Depuis la répétition générale du spectacle - concert (21 février 1920), les dîners du samedi se font rue Pierre-Demours. Jean Cocteau y a découvert un lieu clandestin tenu par un ancien forçat, René de Amouretti : deux pièces sans aucun meuble où l'on sert des boissons et une vague nourriture. Assis sur la moquette, on écoute quelques musiciens jouer de la guitare hawaïenne, un instrument tout récemment apparu en France. C'est là que le 6 mars 1920 naît l'idée de fonder un journal qui constituerait une réponse directe de Cocteau à l'ostracisme perpétré contre lui par les revues dadaïstes. Le «Coq» s'annonce résolument anti-dada. (Il) apparaît généralement comme l'organe d'expression du Groupe des Six. Il est vrai que, décidés à ne pas avouer d'esthétique commune, les Six ont cependant signé de leurs six noms les fascicules du «Coq». Janvier 1921. Les dîners du samedi sont maintenant connus et le clan s'augmente, non seulement d'artistes, mais de curieux. Bien souvent, des invités de passage élargissent le cercle, des étrangers surtout. L'intimité s'en ressent. La bande fréquente un restaurant après l'autre sans découvrir l'endroit idéal. On est un peu las du cirque, cette «école de travail, de force discrète, de grâce utile» où, depuis le boeuf sur le toit on continuait à aller chercher une leçon d'équilibre, et les samedis se terminent à présent porte Maillot, chez la danseuse Caryathis, la future Elise Jouhandeau. Pour elle, bientôt, Satie écrira «La belle Excentrique». Quelques temps auparavant, Louis Moysès, un garçon qui végétait dans les Ardennes (...) avait décidé de tenter sa chance dans la capitale où il souhaitait monter une affaire. Au hasard de ses recherches, il tomba sur un bar, au 17 de la rue Duphot, le «Gaya». On y servait du vin espagnol. Le local était minuscule et ses murs recouverts de céramiques bleu ciel lui valaient de la part de certains habitués le gracieux surnom de «bar-lavabo». Séduit malgré tout, Moysès chercha une idée pour lancer l'endroit. (...) Il engagea Jean Wiener pour tenir le piano. Aucun choix n'aurait pu être meilleur. Ce jeune homme très doué, aimant le jazz autant que les classiques, «interprétait de la musique syncopée avec une aisance aérienne» (citation de Milhaud). Milhaud, son ancien condisciple au Conservatoire, ayant souvent exprimé l'envie d'un lieu où ses amis et lui seraient chez eux, il lui proposa alors de transporter leurs réunions hebdomadaires au «Gaya». Et Darius de courir aussitôt annoncer à Jean Cocteau : «Je t'apporte un bar !» Dans la chambre de la rue d'Anjou, ce brave Moysès allait gagner instantanément l'amitié du poète en demandant, le doigt pointé vers la photographie de Rimbaud : «N'ai-je pas déjà vu ce visage-là quelque part ?» On décida de l'inauguration du bar. «En cinq ou six coups de téléphone, Cocteau mobilisa tout Paris» (Jean Wiener). Avec le piano, il fallait un matériel de drummer. Stravinsky, qui composait «Noces» prêta une caisse et une timbale sur lesquelles, les nuits suivantes, Cocteau s'essaierait à reproduire la «catastrophe apprivoisée» - le jazz - qui l'avait tellement frappé chez le premier orchestre négro-américain entendu en 1918 au casino de Paris. Peu avant l'ouverture, Vance Lowry se présenta. C'était un Noir charmant et gai parlant très bien le français avec un délicieux accent américain, joueur de saxophone et de banjo appelé à devenir un des grands personnages des premiers temps du Gaya. Le 22 février 1921, le Gaya devient le témoin de la grande mêlée parisienne. Cocteau, les Hugo, Radiguet, Auric s'y rendent à la sortie d'un film joué par Sessue Hayakawa. Dans une ambiance nettement plus détendue qu'au Certa, les seuls Dadas capables d'innocente frivolité, Picabia, le torse bombé, l'oeil charmeur, et Tzara, sa mèche sur le front, son monocle à ruban noir, son col dur à coins cassés vierge de cravate et ses gants blancs, sont déjà occupés à préparer des cocktails au milieu d'une foule. Imposant par sa carrure et sa taille, le cheveu blond-roux, cordial, souriant, le regard chaleureux et généreux, Moysès reçoit, place, s'arrange pour que chacun trouve une table, un coin, un renfoncement : Gide, Marc Allégret, Misia Sert, Paul Poiret, Diaghilev, Boris Kochno, Arthur Rubinstein, Mistinguett, Maurice Chevalier, les Noailles, les Faucigy-Lucinge, la «rotschilderie», ... A partir du deuxième jour, dès dix heures, il est difficile de respirer dans l'étroite salle où l'on dîne pour dix francs. Le public vient si nombreux qu'il ne tarde pas à se retrouver sur le trottoir, voire sur la chaussée. Dans la petite rue Duphot, les taxis, les voitures provoquent des embouteillages égayés par des concerts d'avertisseurs. Le Gaya réunit désormais tous les jours, ou plutôt tous les soirs de la semaine, les samedistes, spontanément heureux d'être là. Enchanté, Moysès, que tout le monde appelle Moïse, ne cesse de les remercier d'être ainsi venus préluder à sa réussite et garnit ses murs de petites affiches multicolores portant chacune un de leurs noms. Comme les clients arrivent toujours après eux et partent avant eux, il y a un moment où ils sont absolument libres de faire de la musique. Wiéner a fait venir d'Amérique les plus récentes partitions de Gershwin, de Youmans, de Henderson. Vance Lowry et lui passent sans transition des rags, des foxs à la mode aux morceaux les plus célèbres de Bach. Et pour les accompagner à la batterie avec une inconcevable assurance, Jean Cocteau, toutes manches retroussées, n'est jamais le dernier. Parmi les dadaïstes, le bruit circule qu'il a enfin trouvé sa voie comme tenancier de boîte de nuit. «J'étais à jamais perdu, compromis, ironisera-t-il. Nous étions sauvés !» Dès le milieu de la saison, le succès croissant du Gaya amène Moysès à transférer son bar dans un local plus grand, plus agréable. Il déniche au 28, rue Boissy-d'Anglas, toujours dans le quartier de la Madeleine, deux boutiques assez vastes situées de part et d'autre d'une porte cochère. A gauche, il décide d'installer la partie restaurant ; à droite, le bar. Pour ce nouveau repaire, dont l'heureux décor (abat-jour de parchemin, lampes-appliques, sièges d'acier) sera ensuite adopté par les intérieurs bourgeois, il faut une enseigne qui fasse sensation. Elle aura immédiatement valeur de symbole, tout en accréditant le racontar selon lequel Cocteau dirige un bar : ce sera le «Boeuf sur le Toit», et celui-ci, cette fois, ne va rien avoir d'un Nothing-Happens Bar ... Il suffit à Moysès d'en ouvrir les portes, le 10 janvier 1922, pour que beaucoup de choses s'y passent. Conclusion inévitable de toutes les soirées chics de la capitale durant les années vingt, creuset de l'effervescence créatrice de l'époque, l'établissement voit se nouer et se dénouer toutes sortes de projets et d'aventures. On pénètre là dans une société dont les canons sont différents de l'autre, mêlant la fraternité des ateliers et le savoir-vivre des salons. La hiérarchie y est fondée non sur la naissance, la fortune, le talent, mais sur la jeunesse, la gaieté, le tempérament poétique. (...) Il est sans exemple qu'un bar ait jamais laissé sa trace dans l'histoire de l'art avant la période où, agitant un cocktail de chandails, de flanelles grises, de décolletés, de tailleurs, d'habits, le Boeuf sur le Toit accueille musiciens et banquiers, ministres et poètes, princesses et cocotes, éditeurs et marchands de tableaux, acteurs débutants et bohèmes dorés, jeunes gens avides de côtoyer les célébrités et aussi gens du monde, ceux que Diaghilev désigne tendrement comme «nos chers snobs», toujours prêts à s'enticher d'une nouvelle mode. Est-ce d'avoir constitué un point tangentiel entre le temps perdu et celui qui n'existait pas encore qui mérita l'immortalité à ce modeste bar ?
Un décrochement prolonge la salle carrée, occupé par le piano à queue et le comptoir d'acajou brillant de verres à mélanges et de bouteilles, au-dessus duquel est accroché «l'Oeil cacodylate», un grand tableau collectif de Francis Picabia constituant aujourd'hui le plus beau livre d'or du XXe siècle. (note : Picabia peignit un oeil grand ouvert, très réaliste. Sur le restant de la toile demeuré vierge, chacun des visiteurs fut invité à inscrire ce qui lui passait par la tête ou simplement à signer. Le tableau se trouve aujourd'hui au musée national d'Art moderne du Centre Georges-Pompidou). Le bar et le restaurant ne communiquent que par le trottoir ou la cour intérieure de l'immeuble, ce qui ne manque pas de créer des allées et venues bruyantes qui ne font pas toujours la joie des autres locataires. Une nuit, dans cette cour obscure, Poulenc et Jean Borlin font une partie de pétanque avec des boules de rampe d'escalier, à la lueur d'une bougie. On ignore joyeusement l'heure réglementaire, la mesure, le petit jour.(..) De dix heures à deux heures du matin, (Clément Doucet) joue (au piano) tout en poursuivant avec flegme la lecture de «la Reine Margot», des «Trois Mousquetaires» ou de quelque roman policier posé sur son pupitre. Le livre est toujours là sans que l'efficacité de son jeu en soit un instant contrariée. Tard dans la nuit, succédant au pianiste, Vance Lowry et un petit orchestre noir ajoutent à ce lieu d'extrême réussite le sortilège des premiers blues et font danser les couples de plus en plus serrés. Jean Cocteau dira que le titre de son allocution «d'un ordre considéré comme une anarchie» résume l'esprit d'un météore de rires, de scandales, de prospectus, de dîners hebdomadaires, de tambours, de larmes, de deuils, de naissances, de songes qui étonna Paris entre 1918 et 1923. En s'élargissant, le groupe a perdu son homogénéité, les dîners cessent aussi simplement qu'ils ont commencé. Les samedistes n'ont plus de raison d'être. Ils continuent bien sûr à se voir, à écouter pleurer le saxo de Vance Lowry, chaque soir au Boeuf sur le Toit. En 1928, à l'issue d'un long procès, Moysès dut quitter le 28 de la rue Boissy-d'Anglas. Pour quelques mois, le Boeuf trouva abri au premier étage d'une maison en face, au 21. La saison suivante, quand on détruisit le bel immeuble dont il occupait une partie du rez-de-chaussée et le sous-sol, il s'installa au 25 rue de Penthièvre, puis à la veille de la Seconde Guerre, avenue Pierre-Ier-de-Serbie et enfin 34 rue du Colisée au lendemain de la Libération. Le restaurant, le bar continuèrent longtemps à jouer un rôle dans la vie nocturne parisienne, mais malgré de brefs moments de gloire retrouvée, les Boeufs successifs, qui témoignèrent toujours du grand goût de Moysès ne réalisèrent plus jamais le miracle qu'avait été le premier établissement. Cocteau lui portant bonheur, Moysès a ouvert «Le grand Ecart» et «Les Enfants Terribles» qui n'ont pas survécu à la crise économique des années trente.
|