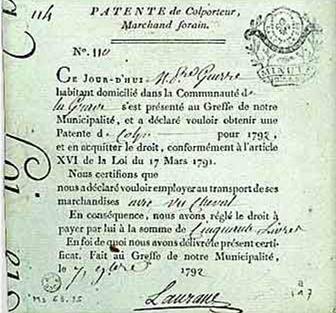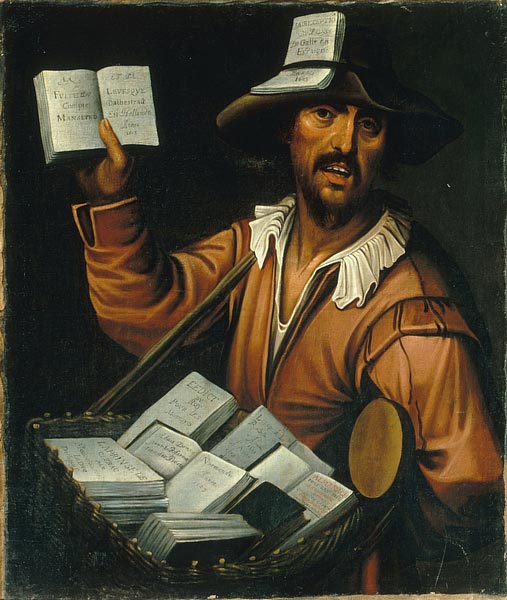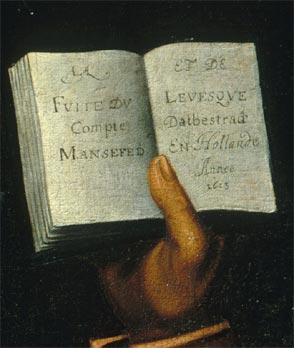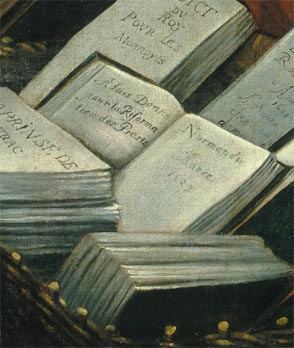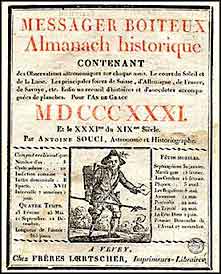|
 |
|
L'intérieur d'une hotte
d'une quarantaine de kilos |
Sous
l’Ancien Régime, les marchands
ambulants transportaient dans une balle divers articles de mercerie
(rubans, mouchoirs, fils, chaussettes) et des objets de pacotille ; on les
qualifiait de "merciers vagabonds". Ceux qui portaient leurs
 marchandises
sur un petit éventaire suspendu au cou prirent le nom de colporteurs. Au
XVIe siècle, les marchands ambulants commencent à adjoindre à leurs
articles habituels des ouvrages bon marché, de petit format, imprimés sur
un papier de mauvaise qualité, parfois enrichis de gravures sur bois.
Cette
littérature de colportage fut le
moyen le plus efficace de pénétration du livre dans le milieu rural et
populaire. La littérature de colportage rassemblait deux catégories
d’ouvrages : livres de piété et livres didactiques, d’une part
(almanachs, guides de médecine et d’agriculture), livres de divertissement
(recueils de contes, de chansons, romans sentimentaux, faits divers
horrifiants ou légendes
et les
feuilles d'actualité " les canards"),
d’autre part. Les
canards sont généralement illustrés d'images gravées sur boi marchandises
sur un petit éventaire suspendu au cou prirent le nom de colporteurs. Au
XVIe siècle, les marchands ambulants commencent à adjoindre à leurs
articles habituels des ouvrages bon marché, de petit format, imprimés sur
un papier de mauvaise qualité, parfois enrichis de gravures sur bois.
Cette
littérature de colportage fut le
moyen le plus efficace de pénétration du livre dans le milieu rural et
populaire. La littérature de colportage rassemblait deux catégories
d’ouvrages : livres de piété et livres didactiques, d’une part
(almanachs, guides de médecine et d’agriculture), livres de divertissement
(recueils de contes, de chansons, romans sentimentaux, faits divers
horrifiants ou légendes
et les
feuilles d'actualité " les canards"),
d’autre part. Les
canards sont généralement illustrés d'images gravées sur boi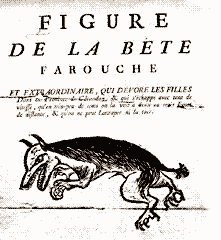 s
de fil et imprimés simplement à l'encre noire. C'est la plus simple de
toutes les techniques permettant la multiplication des images; celle
qu'utilisaient traditionnellement les graveurs populaires. Elle présentait
l'avantage, pour les artisans modestes qu'étaient les canardiers, de
nécessiter un matériel très réduit: un canif, quelques gouges; à la
limite, la presse typographique n'est pas absolument indispensable au
tirage. Pour répondre à l'attente de la clientèle et exploiter les
événements "à chaud, le canard doit être gravé, composé et tiré très vite.
De là vient sa facture souvent sommaire et l'imperfection de ses tirages
mais aussi, peut-être, le caractère expressif qui fait le charme de ses
illustrations. Contrairement aux images populaires qui, à partir du milieu
du XIX° siècle, subissent l'influence de plus en plus affadissante de
l'art savant, le canard garde généralement un style brutal et franc qui
perpétue les meilleures traditions de la gravure populaire. s
de fil et imprimés simplement à l'encre noire. C'est la plus simple de
toutes les techniques permettant la multiplication des images; celle
qu'utilisaient traditionnellement les graveurs populaires. Elle présentait
l'avantage, pour les artisans modestes qu'étaient les canardiers, de
nécessiter un matériel très réduit: un canif, quelques gouges; à la
limite, la presse typographique n'est pas absolument indispensable au
tirage. Pour répondre à l'attente de la clientèle et exploiter les
événements "à chaud, le canard doit être gravé, composé et tiré très vite.
De là vient sa facture souvent sommaire et l'imperfection de ses tirages
mais aussi, peut-être, le caractère expressif qui fait le charme de ses
illustrations. Contrairement aux images populaires qui, à partir du milieu
du XIX° siècle, subissent l'influence de plus en plus affadissante de
l'art savant, le canard garde généralement un style brutal et franc qui
perpétue les meilleures traditions de la gravure populaire.
Les
premiers succès de la littérature de colportage
furent
Les Quatre fils Aymon, adaptation d’une chanson de geste du XIIe
siècle, et le Calendrier des bergers, prototype des almanachs et
des encyclopédies populaires. Dans la mesure où ils faisaient aussi office
de libraires ambulants, et à l’occasion relais de propagande politique,
les colporteurs ont parfois été considérés comme de dangereux prosélytes
par le pouvoir.
La profession de colporteur a
connu un essor grandissant depuis le XVII° siècle jusqu'à la fin du XIX°
siècle. En 1611, on dénombre 46 colporteurs autorisés.
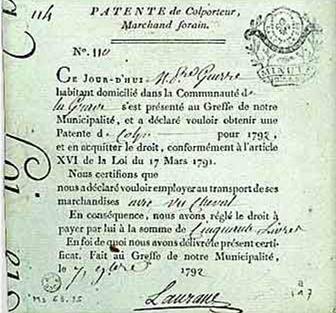
Leur nombre passe à 3500 à la
fin du règne de Louis-Philippe. Les colporteurs se sont recrutés, très
tôt, parmi les petits paysans ou les journaliers qui recherchaient par
cette activité saisonnière, compatible avec le travail de la terre, un
complément de ressources durant la morte saison. Les colporteurs n'
avaient donc rien à voir avec des vagabonds se déplaçant au hasard des
chemins. Les lois de 1849 et 1852 imposent trois
conditions pour la vente d'une publication par colportage: l'examen
préalable de l'ouvrage par une commission, l'apposition d'une estampille
sur chaque exemplaire, le port d'un passeport spécial par tous les
colporteurs.
Les
autorités politiques furent toujours tentées de la réglementer, avant de
l'interdire sous Napoléon III.
D'
après :
http://www.lerecoursauxforets.org/article.php3?id_article=41
Très
longtemps, les historiens se sont exclusivement intéressés à la culture
des élites, au mépris de la culture populaire. Mais ils ont fini par
donner la parole à cette majorité silencieuse dont la littérature n'est
pas moins passionnante que celle enseignée par nos manuels. En effet, à
travers ces petits livres bleus vendus par colportage du XVIIe au XIXe
siècle, nous entrons dans l'imaginaire de ces paysans, artisans,
boutiquiers et commerçants qui constituent le tissu social de l'ancienne
France. La Bibliothèque bleue de Troyes (mais aussi de Rouen, de Caen ou
d'ailleurs) constitue le corpus le plus représentatif et le plus étendu de
cette culture populaire.
La
Bibliothèque bleue
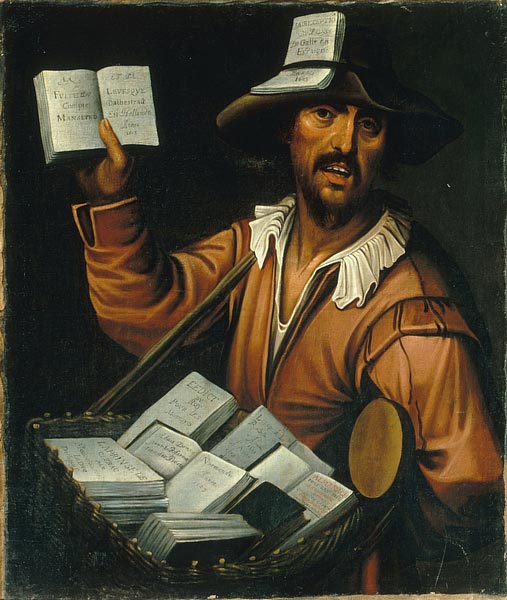
Le colporteur
École française, XVIIe siècle
Huile sur toile
En 1602,
Jacques Oudot, imprimeur à Troyes, lance une série de livrets - imprimés
sur du papier bon marché, avec des caractères usagés et illustrés
d’anciennes gravures sur bois - qu’il fait vendre par des colporteurs
(merciers ou "crieurs") dans toute la France. De petits formats (14 * 7 ou
21 * 15 cm), ils étaient présentés sous une couverture de papier bleu qui
servait habituellement à emballer les pains de sucre.
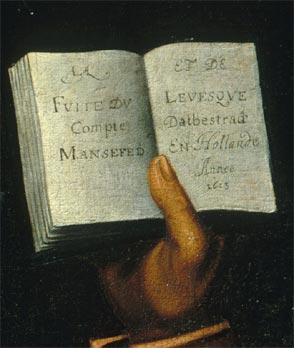 Une
large audience : Les livrets imprimés à Troyes seront vendus jusqu’à la
première moitié du XIXe siècle, et le modèle en est repris et imité dans
toute la France. On ne connaît pas précisément le nombre d’exemplaires
édités (sans doute des millions), et celui des titres est évalué à environ
1 200. Dans une France qui est à l’époque en partie analphabète, le succès
de ces livres bleus ne manque pas de surprendre, et différentes
explications ont été avancées. Si tout le monde ne sait pas lire, il y a
dans chaque village au moins un lecteur qui peut faire une lecture
collective ; d’autre part, posséder une de ces brochures, c’est pouvoir se
familiariser avec les signes écrits et se réserver une possibilité
d’acquérir ce savoir. Les premiers acheteurs ont d’abord été
principalement des citadins - la petite et la moyenne bourgeoisie - puis,
à partir du XVIIIe siècle, en majorité des ruraux et des paysans. Les
éditeurs s’adaptent aux goûts et aux exigences de ce public, peu habitué à
la lecture, en restant fidèles à des formes et des motifs précis, en
résumant ou en abrégeant les textes d’origine. Les textes Une
large audience : Les livrets imprimés à Troyes seront vendus jusqu’à la
première moitié du XIXe siècle, et le modèle en est repris et imité dans
toute la France. On ne connaît pas précisément le nombre d’exemplaires
édités (sans doute des millions), et celui des titres est évalué à environ
1 200. Dans une France qui est à l’époque en partie analphabète, le succès
de ces livres bleus ne manque pas de surprendre, et différentes
explications ont été avancées. Si tout le monde ne sait pas lire, il y a
dans chaque village au moins un lecteur qui peut faire une lecture
collective ; d’autre part, posséder une de ces brochures, c’est pouvoir se
familiariser avec les signes écrits et se réserver une possibilité
d’acquérir ce savoir. Les premiers acheteurs ont d’abord été
principalement des citadins - la petite et la moyenne bourgeoisie - puis,
à partir du XVIIIe siècle, en majorité des ruraux et des paysans. Les
éditeurs s’adaptent aux goûts et aux exigences de ce public, peu habitué à
la lecture, en restant fidèles à des formes et des motifs précis, en
résumant ou en abrégeant les textes d’origine. Les textes
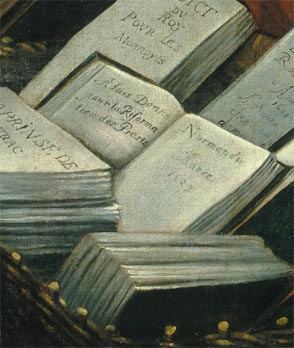 proviennent
d’un répertoire déjà édité et pour lequel les droits du premier éditeur
sont expirés. Tous les sujets - recettes de cuisine, astrologie, plantes -
et toutes les littératures y sont représentés. Si dans le fonds édité à
Troyes se trouvent encore certains romans de chevalerie, ils disparaissent
à la fin du XVIIe siècle, alors que les contes n’y figurent qu’à partir du
XVIIIe et surtout du XIXe siècle (Perrault, Mme d’Aulnoy et Mlle
L’Héritier). Des hommes de lettres ou des ecclésiastiques ont parfois
rédigé certains livrets sans toutefois les signer, et la plupart des
livres bleus sont anonymes. Les imprimeurs et les ouvriers typographes
s’improvisent auteurs et utilisent leur propre fonds, puisent dans la
tradition orale ou les récits apocryphes. C’est ainsi que l’on trouve au
catalogue Juif errant, Noëls, Jargon de l’argot,
Bonhomme Misère, Vie de saint Claude, Malice des femmes,
Misère des domestiques, Sermons et consolation de cocus… Au
XIXe siècle, la Bibliothèque bleue n’est plus seule à proposer des
rééditions d’œuvres, et on l’accuse d’être dangereuse et de fomenter les
révolutions. Mais il n’y aura même pas à interdire sa publication, car le
développement industriel et les progrès de l’alphabétisation provoqueront
le déclin de cette littérature. proviennent
d’un répertoire déjà édité et pour lequel les droits du premier éditeur
sont expirés. Tous les sujets - recettes de cuisine, astrologie, plantes -
et toutes les littératures y sont représentés. Si dans le fonds édité à
Troyes se trouvent encore certains romans de chevalerie, ils disparaissent
à la fin du XVIIe siècle, alors que les contes n’y figurent qu’à partir du
XVIIIe et surtout du XIXe siècle (Perrault, Mme d’Aulnoy et Mlle
L’Héritier). Des hommes de lettres ou des ecclésiastiques ont parfois
rédigé certains livrets sans toutefois les signer, et la plupart des
livres bleus sont anonymes. Les imprimeurs et les ouvriers typographes
s’improvisent auteurs et utilisent leur propre fonds, puisent dans la
tradition orale ou les récits apocryphes. C’est ainsi que l’on trouve au
catalogue Juif errant, Noëls, Jargon de l’argot,
Bonhomme Misère, Vie de saint Claude, Malice des femmes,
Misère des domestiques, Sermons et consolation de cocus… Au
XIXe siècle, la Bibliothèque bleue n’est plus seule à proposer des
rééditions d’œuvres, et on l’accuse d’être dangereuse et de fomenter les
révolutions. Mais il n’y aura même pas à interdire sa publication, car le
développement industriel et les progrès de l’alphabétisation provoqueront
le déclin de cette littérature.
La
réglementation sur la littérature de colportage : Le colportage de livres,
qui touchait à partir du XVIIe siècle non seulement une clientèle
paysanne, mais aussi une bourgeoisie de province, fut très vite
réglementé. La littérature de colportage représentait en effet un danger à
la fois pour les autorités, en propageant des textes subversifs, et pour
le privilège corporatiste des libraires. Une loi de 1628 réserve
d’ailleurs le colportage de livres aux anciens imprimeurs, aux libraires
et aux relieurs dans l’impossibilité d’exercer leur métier. La Révolution
libéra d’abord le colportage de ses entraves, mais le décret du 29 mars
1793 prévoyait des peines sévères contre les colporteurs, les auteurs et
les éditeurs d’écrits incitant à la dissolution de la Convention
nationale. Sous la Restauration, puis pendant la monarchie de Juillet et
au cours du Second Empire, les colporteurs dont le fonds n’était plus
seulement constitué de livres de religion, de vies des saints ou de
manuels de civilité "puérile et honnête" firent l’objet d’une surveillance
accrue. Une loi de 1833 créa une commission chargée d’écarter tous les
livres injurieux pour l’Église, contraires aux bonnes mœurs, ou présentant
un caractère polémique à l’égard du régime et de ses représentants. À
partir de 1852, les colporteurs sont tenus à l’estampillage des livres par
la préfecture. Dans les dix millions d’exemplaires vendus à travers la
France dominent alors les œuvres sentimentales préromantiques (Paul et
Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre), les romans de Mme Cottin (Élisabeth
ou les Exilés de Sibérie), les aventures mélodramatiques de
Ducray-Duminil (Victor ou l’Enfant de la forêt, Lolotte et
Fanfan), aux côtés des valeurs sûres de la Bibliothèque bleue, comme
l’Histoire de Robert le Diable ou les Contes de Perrault.
Avec
l’implantation jusque dans les moindres bourgades de commerçants qui
vendaient également des livres, la littérature de colportage commença à
disparaître. Elle a toutefois survécu jusque dans les années 1930 dans
quelques zones rurales particulièrement difficiles d’accès.
Les
almanachs : On
fait remonter l’origine des almanachs aux Grecs et aux
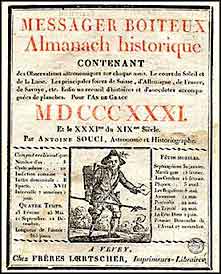 Romains,
et c’est avec l’expansion du christianisme que leur usage s’est propagé en
Europe : ils étaient placardés dans les églises avant l’invention de
l’imprimerie. On y trouve des observations purement astronomiques, des
prédictions sur les changements de temps ou les événements politiques, des
conseils sur la conduite des activités en fonction des jours fastes ou
néfastes, les dates des événements communautaires (fêtes et foires).
Souvent abondamment illustrés, ils peuvent être consultés par des
illettrés. Les signes astrologiques dont ils sont composés peuvent être
facilement déchiffrés dès qu’on en a compris le code. Le Calendrier des
bergers, qui paraît à la fin du XVe siècle, en représente une sorte
d’archétype. C’est un des premiers ouvrages techniques imprimés et un
véritable traité de vie à la campagne, de l’astronomie aux recettes de
cuisine. Il restera inchangé pendant trois siècles, reprenant les mêmes
figures et les mêmes dessins. Certains almanachs ont eu des auteurs
illustres : Rabelais en publie plusieurs sous son nom en 1534 et 1535,
Nostradamus en 1550, et Benjamin Franklin en 1732. Au XVIIe siècle paraît
l’almanach de Mathieu Laensberg - dont l’influence est bientôt combattue
par l’Almanach royal en 1679 -, et le Messager boiteux, qui est
publié à Bâle, obtient un immense succès. Au XVIIIe siècle, devenus un
phénomène de mode, les recueils abondent (Les Dons de Cérès, Les
Bijoux des dames), et, au XIXe siècle, ils deviennent instruments
politiques aux mains de pamphlétaires, anticipant l’apparition des
journaux. Romains,
et c’est avec l’expansion du christianisme que leur usage s’est propagé en
Europe : ils étaient placardés dans les églises avant l’invention de
l’imprimerie. On y trouve des observations purement astronomiques, des
prédictions sur les changements de temps ou les événements politiques, des
conseils sur la conduite des activités en fonction des jours fastes ou
néfastes, les dates des événements communautaires (fêtes et foires).
Souvent abondamment illustrés, ils peuvent être consultés par des
illettrés. Les signes astrologiques dont ils sont composés peuvent être
facilement déchiffrés dès qu’on en a compris le code. Le Calendrier des
bergers, qui paraît à la fin du XVe siècle, en représente une sorte
d’archétype. C’est un des premiers ouvrages techniques imprimés et un
véritable traité de vie à la campagne, de l’astronomie aux recettes de
cuisine. Il restera inchangé pendant trois siècles, reprenant les mêmes
figures et les mêmes dessins. Certains almanachs ont eu des auteurs
illustres : Rabelais en publie plusieurs sous son nom en 1534 et 1535,
Nostradamus en 1550, et Benjamin Franklin en 1732. Au XVIIe siècle paraît
l’almanach de Mathieu Laensberg - dont l’influence est bientôt combattue
par l’Almanach royal en 1679 -, et le Messager boiteux, qui est
publié à Bâle, obtient un immense succès. Au XVIIIe siècle, devenus un
phénomène de mode, les recueils abondent (Les Dons de Cérès, Les
Bijoux des dames), et, au XIXe siècle, ils deviennent instruments
politiques aux mains de pamphlétaires, anticipant l’apparition des
journaux.
Extrait d'u
ouvrage de la Bibliothèque Bleue
d'après :
http://www.fabula.org/actualites/article6507.php
|


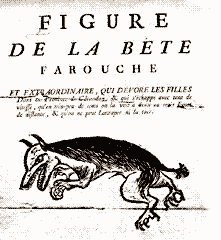 s
de fil et imprimés simplement à l'encre noire. C'est la plus simple de
toutes les techniques permettant la multiplication des images; celle
qu'utilisaient traditionnellement les graveurs populaires. Elle présentait
l'avantage, pour les artisans modestes qu'étaient les canardiers, de
nécessiter un matériel très réduit: un canif, quelques gouges; à la
limite, la presse typographique n'est pas absolument indispensable au
tirage. Pour répondre à l'attente de la clientèle et exploiter les
événements "à chaud, le canard doit être gravé, composé et tiré très vite.
De là vient sa facture souvent sommaire et l'imperfection de ses tirages
mais aussi, peut-être, le caractère expressif qui fait le charme de ses
illustrations. Contrairement aux images populaires qui, à partir du milieu
du XIX° siècle, subissent l'influence de plus en plus affadissante de
l'art savant, le canard garde généralement un style brutal et franc qui
perpétue les meilleures traditions de la gravure populaire.
s
de fil et imprimés simplement à l'encre noire. C'est la plus simple de
toutes les techniques permettant la multiplication des images; celle
qu'utilisaient traditionnellement les graveurs populaires. Elle présentait
l'avantage, pour les artisans modestes qu'étaient les canardiers, de
nécessiter un matériel très réduit: un canif, quelques gouges; à la
limite, la presse typographique n'est pas absolument indispensable au
tirage. Pour répondre à l'attente de la clientèle et exploiter les
événements "à chaud, le canard doit être gravé, composé et tiré très vite.
De là vient sa facture souvent sommaire et l'imperfection de ses tirages
mais aussi, peut-être, le caractère expressif qui fait le charme de ses
illustrations. Contrairement aux images populaires qui, à partir du milieu
du XIX° siècle, subissent l'influence de plus en plus affadissante de
l'art savant, le canard garde généralement un style brutal et franc qui
perpétue les meilleures traditions de la gravure populaire.